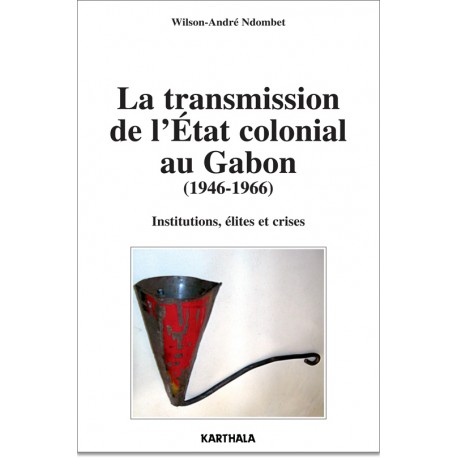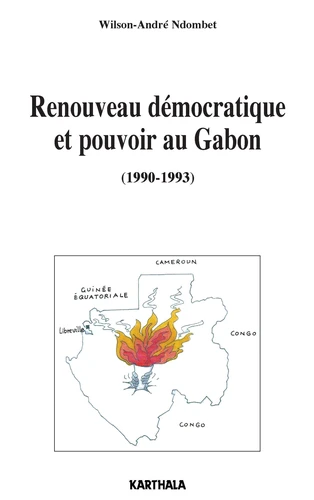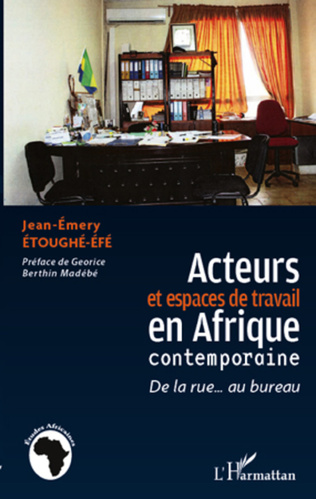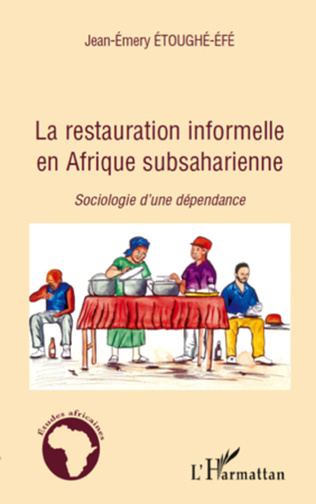Catalogue des œuvres
606 résultats
-
La transmission de l'État colonial au Gabon : 1946-1966, institutions, élites et crises
Le discours du Général de Gaulle du 28 janvier 1944 représenta une ouverture majeure de la doctrine coloniale française et ouvrit aussi une nouvelle page de l'histoire des territoires colonisés d'Afrique noire. Il fut suivi d'un processus marqué par des lois définissant un nouveau statut pour les colonisés et par l'adoption de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette dernière prévoyait, dans le cadre d'une " Union Française ", l'octroi de la citoyenneté française, l'autorisation des partis politiques locaux et leur représentation dans les assemblées parlementaires métropolitaines. La loi Defferre de 1956, puis la Constitution de 1958, instituant une " Communauté franco-africaine ", réalisèrent une nouvelle étape, permettant la démocratisation des processus électoraux en Afrique, la constitution de véritables assemblées et conseils de gouvernement territoriaux. La transmission de l'État colonial était en marche sur le plan politique. Cette évolution s'effectua non sans contradictions au sein des " élites " et au fil de crises multiples. C'est dans ce contexte d'effervescence, qui dissimulait mal les antagonismes entre partisans de tous bords, que le Gabon devint indépendant en 1960. Ainsi émergea un personnel politique et administratif qui, obsédé par son positionnement aux sommets du pouvoir, s'écarta très vite des impérieuses nécessités de la construction d'un nouvel Etat. Mal-gré la présence d'une assistance technique française et d'anciens commis de l'administration coloniale, le Gabon ne parvint pas à combler ce hiatus originel. L'instrumentalisation de la Constitution par le président Léon Mba généra des actes impopulaires, sources d'un malaise persistant dans le pays. Cette dérive autoritaire déboucha sur le putsch du 18 février 1964 qui l'évinça du pouvoir. Il ne fut rétabli in extremis que par une intervention militaire française. C'est l'histoire mouvementée de cette transmission de l'Etat colonial aux Gabonais que W.-A. Ndombet nous décrit ici avec force détails à partir des sources d'archives.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
Renouveau démocratique et pouvoir au Gabon : 1990-1993
A la fin des années 1980, après 21 ans de règne sans partage d'un parti unique, le Gabon entrait dans une période de crise, lourde d'incertitudes. En particulier dans les secteurs de l'administration publique ou privée, on assista à des manifestations multiformes qui avaient pour leitmotiv le renouveau démocratique. Le chef de l'Etat, Omar Bongo tenta d'y répondre en créant soudainement un nouveau parti politique, le Rassemblement social démocratique gabonais (RSDG), où les acteurs politiques de tous bords étaient conviés à préparer le retour au multipartisme intégral. Mais les forces sociales, jusqu'alors silencieuses, montèrent au créneau et rejetèrent sans ambages cette proposition. Après de nombreuses tractations, une Conférence nationale put se réunir de mars à avril 1990. Ses conclusions débouchèrent sur la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Les différents processus électoraux qui se déroulèrent de 1990 à 1993 confirmèrent apparemment cette ouverture politique. Mais la mise en place des nouvelles institutions se fit de manière très décevante, au point de faire redouter le retour à un parti unique. Cet ouvrage a pour objectif de restituer l'histoire de cette tentative d'ouverture démocratique, bientôt suivie par la réélection en 1993 du Président Bongo qui, ensuite, a su reprendre en main la gouvernance politique du pays. A un moment où ce pays semble en passe de connaître un nouveau tournant, le retour sur ce moment significatif peut être éclairant sur son avenir.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
L'organisation administrative du Gabon de 1843 à nos jours
- Auteur : Max Remondo
- Date : 1970
-
Le Droit administratif gabonais
- Auteur : Max Remondo
- Date : 1987
-
Gabon, la postcolonie en débat
- Auteur : Marc Mvé Bekale
- Date : 2003
-
Acteurs et espaces de travail en Afrique contemporaine : de la rue... au bureau
La sociologie du travail qui sert d'appui méthodologique à cet essai permet de problématiser les différentes perceptions du monde professionnel au Gabon et de comprendre la réalité endogène à partir de ses propres déterminismes, pour déconstruire l'imaginaire africain dans sa relation au travail moderne. Le rapport des acteurs à leur espace de travail résulte d'une dynamique de relations d'individus travaillant au même endroit, mais produisant aussi des situations particulières de relations gouvernées par le "jeu social".
- Auteur : Jean-Émery Étoughé-Éfé
- Date : 2011
-
La restauration informelle en Afrique subsaharienne : sociologie d'une dépendance
- Auteur : Jean-Émery Étoughé-Éfé
- Date : 2010
-
Mon mari, mon salaud
- Auteur : Honorine Ngou
- Date : 2017
-
Mariage et violence dans la société traditionnelle Fang au Gabon
Le mariage est un engagement solennel qui nécessite le consentement de l'homme et de la femme. Cependant, dans bon nombre de sociétés anciennes des cinq continents, on ne le considérait pas souvent comme un acte volontaire qui engageait deux personnes, mais comme l'alliance de deux familles. Cet ouvrage associe deux notions diamétralement opposées et montre le préjudice causé à de toutes petites filles mariées de force à des hommes âgés. Il permet également de voir l'évolution dans les mentalités et les pratiques concernant le mariage de la jeune fille fang.
- Auteur : Honorine Ngou
- Date : 2007
-
Confidences d'un africain : entretiens avec Christian Casteran
- Auteur : Omar Bongo
- Date : 1994