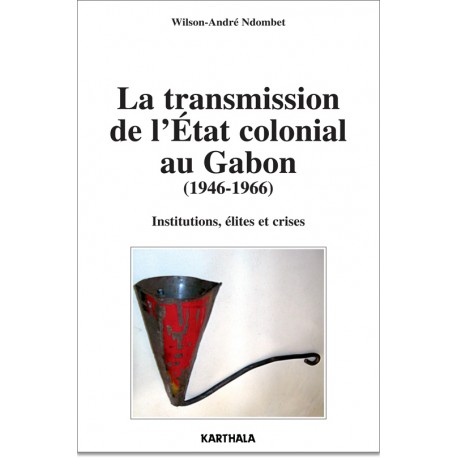Catalogue des œuvres
411 résultats
-
Le NEPAD : histoire, défis et bilan 10 ans après
Ce livre s'inscrit dans le thème de la formation des institutions autour d'une dynamique collective de changement politique. Il dresse à partir des temporalités successives un bilan de l'évolution du NEPAD et des forces politiques en Afrique, leurs interactions avec le niveau local et global, les stratégies véhiculées par les acteurs influents ainsi que leur emprise sur le jeu politique. Dix ans après sa création, quelle évaluation peut-on en faire?
- Auteur : Patrice Moundounga Mouity
- Date : 2013
-
L'histoire romaine dans les universités africaines : passer les examens sans fraude
- Auteur : Hugues Mouckaga
- Date : 2010
-
La culture de la paix, une inspiration africaine
Qui dit : « culture de la paix » entend en écho : « UNESCO ». À cette dernière est associée ce concept, dont la source d'inspiration est l'Afrique. C'est sur ce continent que le concept de « culture de la paix » a été pour la première fois défini lors d'un congrès organisé par l'UNESCO en Côte d'Ivoire, en 1989. Après une décennie d'expériences sur le terrain, ledit concept rentre à plein titre dans l'Agenda des Nations Unies. C'est l'histoire de ce concept de « culture de la paix » que retrace cet ouvrage.
- Auteur : Juste-Joris Tindy-Poaty
- Date : 2020
-
Déportés politiques au bagne de Ndjolé, Gabon, 1898-1913 : l'almamy Samory Touré, cheikh Amadou Bamba Mbacké, Dossou Idéou, Aja Kpoyizoun et les autres
Au départ furent les galères. Puis ce furent les bagnes, implantés en métropole avant d'être étendus aux DOM-TOM (Guyane, Nouvelle-Calédonie). Enfin, il y eut les bagnes coloniaux, institués par Napoléon III et abrités par l'AEF et l'AOF. Il en fut ainsi de Ndjolé, en 1898. Voici examinée la question de la déportation politique à l'époque coloniale vue sous le prisme d'une ville gabonaise. Y séjournèrent, entre autres, l'Almamy Samory Touré, Cheikh Amadou Bamba Mbacké, Dossou Idéou, Aja Kpoyizoun.
- Auteur : Hugues Mouckaga
- Date : 2013
-
L'huile de palme à l'épreuve des marchés mondiaux et de la protection de l'environnement
L'intégration à l'économie mondiale a toujours été présentée comme l'une des clés du développement économique. Selon cette stratégie la richesse augmente pour un pays s'il se spécialise et échange. En conséquence, de nombreux pays en développement se sont lourdement endettés pour intégrer les chaines de valeur mondiales à partir de l'exploitation des avantages concurrentiels que représentaient les cultures d'exportation. La fermeture de facto des marchés occidentaux devenus exigeants est révélatrice de l'impasse dans laquelle se retrouvent les pays producteurs de produits de base notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Les normes sanitaires, les directives sur l'environnement et le climat progressivement mises en place en Europe obligent ces derniers à la réorientation de leurs courants d'échanges vers des marchés asiatiques peu exigeants, quitte à sacrifier l'environnement. Mais, la question de la durabilité des productions reste posée. Les pays producteurs doivent lever les obstacles retardant la transition vers des productions durables. L'accent doit être mis d'une part sur les blocages qui empêchent l'application des lois et règlements et, d'autre part, sur toutes les activités liées à l'exploitation des ressources naturelles.
- Auteur : Aimé Dieudonné Mianzenza
- Date : 2021
-
La transmission de l'État colonial au Gabon : 1946-1966, institutions, élites et crises
Le discours du Général de Gaulle du 28 janvier 1944 représenta une ouverture majeure de la doctrine coloniale française et ouvrit aussi une nouvelle page de l'histoire des territoires colonisés d'Afrique noire. Il fut suivi d'un processus marqué par des lois définissant un nouveau statut pour les colonisés et par l'adoption de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette dernière prévoyait, dans le cadre d'une " Union Française ", l'octroi de la citoyenneté française, l'autorisation des partis politiques locaux et leur représentation dans les assemblées parlementaires métropolitaines. La loi Defferre de 1956, puis la Constitution de 1958, instituant une " Communauté franco-africaine ", réalisèrent une nouvelle étape, permettant la démocratisation des processus électoraux en Afrique, la constitution de véritables assemblées et conseils de gouvernement territoriaux. La transmission de l'État colonial était en marche sur le plan politique. Cette évolution s'effectua non sans contradictions au sein des " élites " et au fil de crises multiples. C'est dans ce contexte d'effervescence, qui dissimulait mal les antagonismes entre partisans de tous bords, que le Gabon devint indépendant en 1960. Ainsi émergea un personnel politique et administratif qui, obsédé par son positionnement aux sommets du pouvoir, s'écarta très vite des impérieuses nécessités de la construction d'un nouvel Etat. Mal-gré la présence d'une assistance technique française et d'anciens commis de l'administration coloniale, le Gabon ne parvint pas à combler ce hiatus originel. L'instrumentalisation de la Constitution par le président Léon Mba généra des actes impopulaires, sources d'un malaise persistant dans le pays. Cette dérive autoritaire déboucha sur le putsch du 18 février 1964 qui l'évinça du pouvoir. Il ne fut rétabli in extremis que par une intervention militaire française. C'est l'histoire mouvementée de cette transmission de l'Etat colonial aux Gabonais que W.-A. Ndombet nous décrit ici avec force détails à partir des sources d'archives.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
L'universalité des questions philosophiques
- Auteur : Léon M'Bou-Yembi
- Date : 2008
-
Confidences d'un africain : entretiens avec Christian Casteran
- Auteur : Omar Bongo
- Date : 1994
-
Éléments de cours de sociologie
- Auteur : Jean-Ferdinand Mbah
- Date : 2009
-
Africanités hégéliennes : alerte à une nouvelle marginalisation de l'Afrique
L'auteur veut nous montrer que les Africains ont des leçons à tirer des propos de Hegel sur l'Afrique. Malgré leurs outrances et leur ethnocentrisme avoués, les propos de Hegel méritent attention si les Africains veulent que leur histoire ne soit pas une page écrite par d'autres. La philosophie africaine est à la croisée des chemins : à elle de choisir si elle veut produire de nouveaux mythèmes (la "philosophie africaine", héritière d'une tradition différente de celle de l'Occident inaugurée par la "philosophie égyptienne"), ou au contraire "penser l'urgence des temps présents".
- Auteur : Gilbert Zuè-Nguéma
- Date : 2006